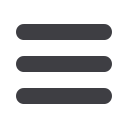
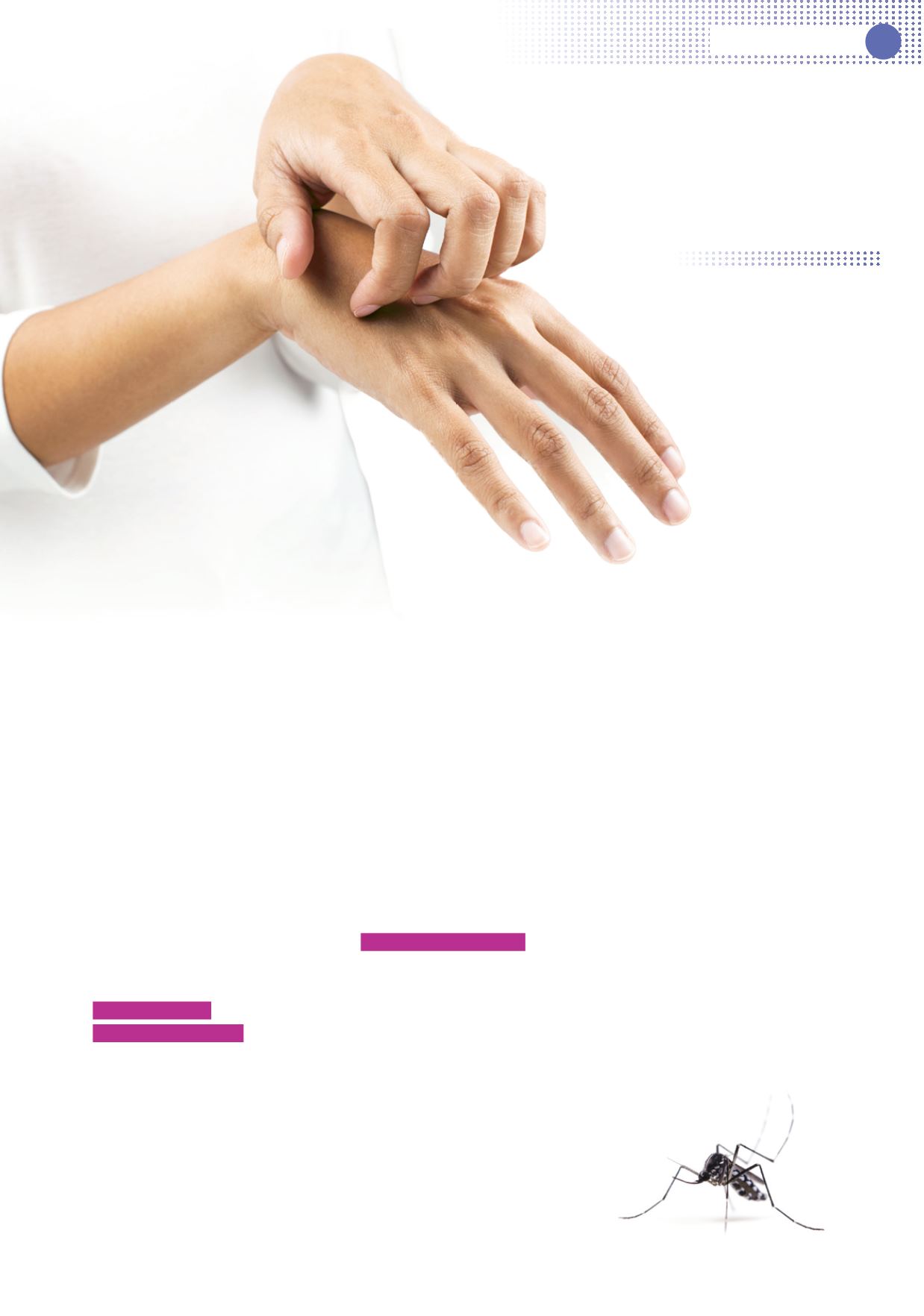
octobre - novembre 2015
•
anform !
55
ma
santé
personnes qui, elles, développent des
symptômes après une période d’incu-
bation de 3 à 12 jours peuvent pré-
senter une fièvre modérée, des maux
de tête, des désordres digestifs, des
douleurs musculaires et, dans plus de
50 % des cas, des éruptions cutanées
(petites taches rouges qui apparaissent
sur le visage et descendent sur le reste
du corps comme pour la rougeole).
“Ce n’est pas une maladie grave”
, ras-
sure le professeur Bruno Hoen. Seul un
cas rare de complication neurologique,
de type syndrome de Guillain-Barré, a
été observé lors de l’épidémie de Poly-
nésie.
Quels risques
pour La Réunion ?
Plusieurs facteurs sont en faveur d’un
risque d’introduction du virus àLa Réu-
nion.
- C’est en effet une maladie en expan-
sion : originaire d’Afrique elle pro-
voque depuis quelques années des
épidémies dans plusieurs régions du
monde.
- Le vecteur (
Aedes
) est présent sur
l’île.
- La population est immunologique-
ment naïve face àce virus.
- Une épidémie touche actuellement
le Brésil. Même si les échanges tou-
ristiques avec ce pays sont relative-
ment faibles, le risque d’importation
du virus ne peut être écarté. Il pourrait
être introduit par un voyageur. L’ARS
Océan Indien invite donc à la pru-
dence et à la prévention, et se tient
prête en cas de suspicion d’infection.
Quelle prévention ?
Il n’existe pas de vaccin.
“La préven-
tion individuelle repose donc essen-
tiellement sur les moyens de protec-
tion contre les piqûres de moustiques
(répulsifs en sprays ou crèmes, serpen-
tins, diffuseurs électriques, vêtements
longs, moustiquaires). La prévention
collective repose sur la lutte anti-vecto-
rielle”,
recommande l’Institut de veille
sanitaire (Invs).
*Arbovirus : virus transmis par les arthropodes suceurs
de sang (moustiques, tiques et phlébotomes).
Le zika détruit
les cellules
du derme
Des chercheurs de l’ins-
titut de recherche pour
le développement, de
l’inserm et de l’institut
pasteur viennent de dé-
couvrir le mode d’action
et de propagation du
virus. Ainsi, lorsque le
moustique pique un
humain, il dépose des
particules virales dans
l’épiderme et le derme
de la victime. En 72 h,
100 % des fibroblastes
(situés dans le derme)
sont infectés. Les autres
cellules sont également
touchées, en particulier
les kératinocytes. Grâce
à l’imagerie électro-
nique, les chercheurs
ont montré que
“le virus
utilise l’autophagie pour
se répliquer. Un méca-
nisme qui consiste en la
dégradation partielle du
cytoplasme par la cellule
elle-même”
. ce phéno-
mène entraîne à terme la
mort cellulaire et favorise
la dissémination du virus.
Le virus cible donc les
cellules cutanées pour se
propager ! ces décou-
vertes constituent une
première sur la biologie
du virus zika et ouvrent
des pistes pour l’élabora-
tion d’un traitement.
source : iRD, Actualité scientifique,
juillet 2015.
© istock
















