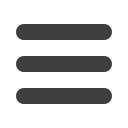
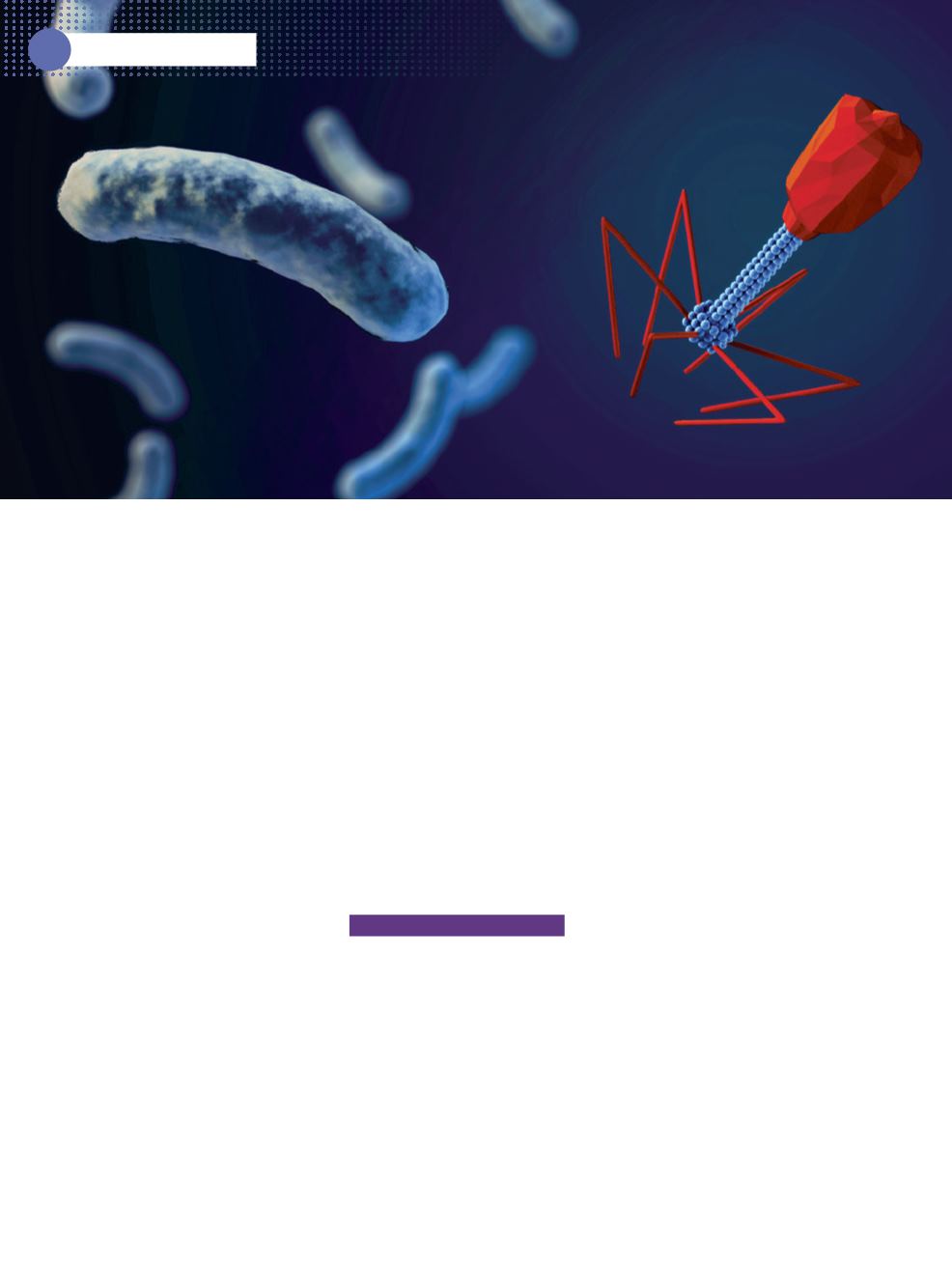
56
anform !
•
mai - juin 2016
ma
santé
de faire partie de l'arsenal théra-
peutique, en France comme ail-
leurs, elle devra faire preuve de son
efficacité et de son innocuité sur
l'homme. Et c'est làque ça coince,
comme l'explique Laurent Debar-
bieux, de l'Institut Pasteur.
“Au-
jourd'hui, seules quelques start-ups
ont investi dans les bactériophages.
Et elles manquent de moyens. Les
grosses firmes pharmaceutiques ne
semblent pas motivées às'engager
dans de lourds essais cliniques.”
Le retour sur investissement est, en
effet, encore incertain. Les bacté-
riophages existent à l'état naturel,
sont faciles à cultiver, purifier et
modifier génétiquement. Les bac-
tériophages, eux-mêmes issus de
la nature, ne sont pas brevetables.
Seuls des cocktails de phages, ou
des procédés, peuvent l'être. La
rentabilité du commerce des bac-
tériophages reste incertaine... Or, la
mise au point d'une nouvelle théra-
pie àbase de phages nécessite de
la recherche.
“Les bactéries et les
bactériophages évoluent constam-
ment, en s'adaptant l'un à l'autre,
précise Laurent Debarbieux.
Cela
signifie qu'une solution de bactério-
phages qui s'est montrée efficace
hier sur une collection de souches
bactériennes peut perdre de son
efficacité vis-à-vis de nouvelles
souches en quelques semaines,
mois ou années. Cela exige de
mettre au point continuellement de
nouvelles solutions.”
MÉDECINE SUR MESURE
Dernier aspect qui contribue au
manque d'enthousiasme des inves-
tisseurs : la législation. Aujourd'hui,
tout médicament administré à un
patient est le fruit d'un processus
de tests et d'homologation sur des
années.
“Le principe de la phago-
thérapie, c'est d'aller trouver dans
la nature le bactériophage capable
•••
de combattre la souche bactérienne
précise qui infecte un patient pré-
cis. Et de le lui administrer. C'est de
la médecine sur mesure”
, poursuit
Laurent Debarbieux. Impossible (et
inutile)de tester la solution virale sur
une large population ! Développer
la phagothérapie passe donc par un
nouveau modèle législatif, qui pour-
rait être long àmettre en place. Ces
inconvénients ne font pas reculer
tout le monde. En août 2015, une
start-up française a lancé le pre-
mier essai clinique d'envergure en
Europe. Baptisé Phagoburn, l'essai
est financé par l'Union européenne,
en collaboration avec le Service de
santé des armées français, le CHU
de Lausanne (Suisse)et l’Académie
militaire royale de Belgique. Environ
200 grands brûlés, dont les plaies
sont infectées, ont reçu un cocktail
composé de différents virus bacté-
riophages. Résultats attendus dans
environ 1 an.
© iStockphoto














