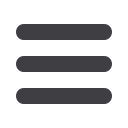

“Certains
antibiotiques à
large spectre sont
soupçonnés de faire
baisser l'efficacité
des contraceptifs
oraux.”
© HEMERA
février - mars 2016
•
anform !
15
question d'actu
•••
montpelliéraine l'a observé en direct.
En septembre dernier, elle a publié
des images inédites présentant deux
substances unies pour déclencher, en-
semble, une réaction cellulaire qu'elles
ne déclencheraient pas isolément. On
y voit les deux molécules à l'intérieur
d'un récepteur, un de ces “interrup-
teurs” qui déclenchent l'activité de nos
cellules. Les deux molécules prises en
flagrant délit d'interaction ne sont pas
anodines. L'une est un composant
d'un pesticide, le chlordane, interdit
au début des années 1980, mais que
l'on détecte encore souvent dans la
population car il persiste longtemps
dans l'environnement. La seconde est
un œstrogène utilisé dans les pilules
contraceptives.
RISQUE MAL ÉVALUÉ
L'effet cocktail ici observé explique
comment agissent certains polluants,
les fameux perturbateurs endocriniens.
Hébergés par nos tissus, ils modifient
l'effet des médicaments que l'on prend.
Ici, l'effet des œstrogènes est décuplé
en présence du pesticide. L'expérience
a été menée sur des cellules, dans un
laboratoire, et reste très théorique. Diffi-
cile de dire si les personnes qui ont été
exposées à tel ou tel pesticide risquent
de connaître des effets indésirables en
prenant telle ou telle pilule. Mais cette
expérience met le doigt sur la nécessité
d'évaluer non seulement les effets des
médicaments eux-mêmes, mais aussi
de leurs interactions. Or aujourd'hui,
on n'exige pas des firmes pharmaceu-
tiques qu'elles évaluent les interac-
tions médicamenteuses lors de leur
demande d'autorisation de mise sur le
marché (AMM). Que ce soit pour mesu-
rer l'efficacité d'un médicament ou la
toxicité d'un polluant, et que les tests
aient lieu au laboratoire sur des cellules
ou en clinique sur des humains, on teste
en général une seule substance active
à la fois. Une situation bien éloignée de
la réalité. Il est rare qu'une prescription
médicale ne comporte qu'un principe
actif. Et même si c’était le cas, nos
organismes sont imprégnés de nom-
breuses autres molécules actives qui
proviennent de l'air que nous respirons
ou des aliments que nous ingérons.
CONTRE-INDICATIONS
Alertée de ce danger, l'Agence natio-
nale de sécurité des médicaments et
des produits de santé (ANSM) a consti-
tué, en 2013, un groupe de travail sur
les interactions médicamenteuses. Ce
groupe, constitué d'une vingtaine d'ex-
perts, évalue les risques à partir de cas
qui leur sont soumis par des médecins
ou à partir de la bibliographie. Il publie
sur internet une liste de médicaments
susceptibles d'interagir. La liste, des-
tinée aux professionnels de santé, est
réactualisée une à deux fois par an.
Elle recense aujourd'hui des milliers
de médicaments ou substances dont
le mélange est formellement contre-
indiqué, simplement déconseillé ou à














