
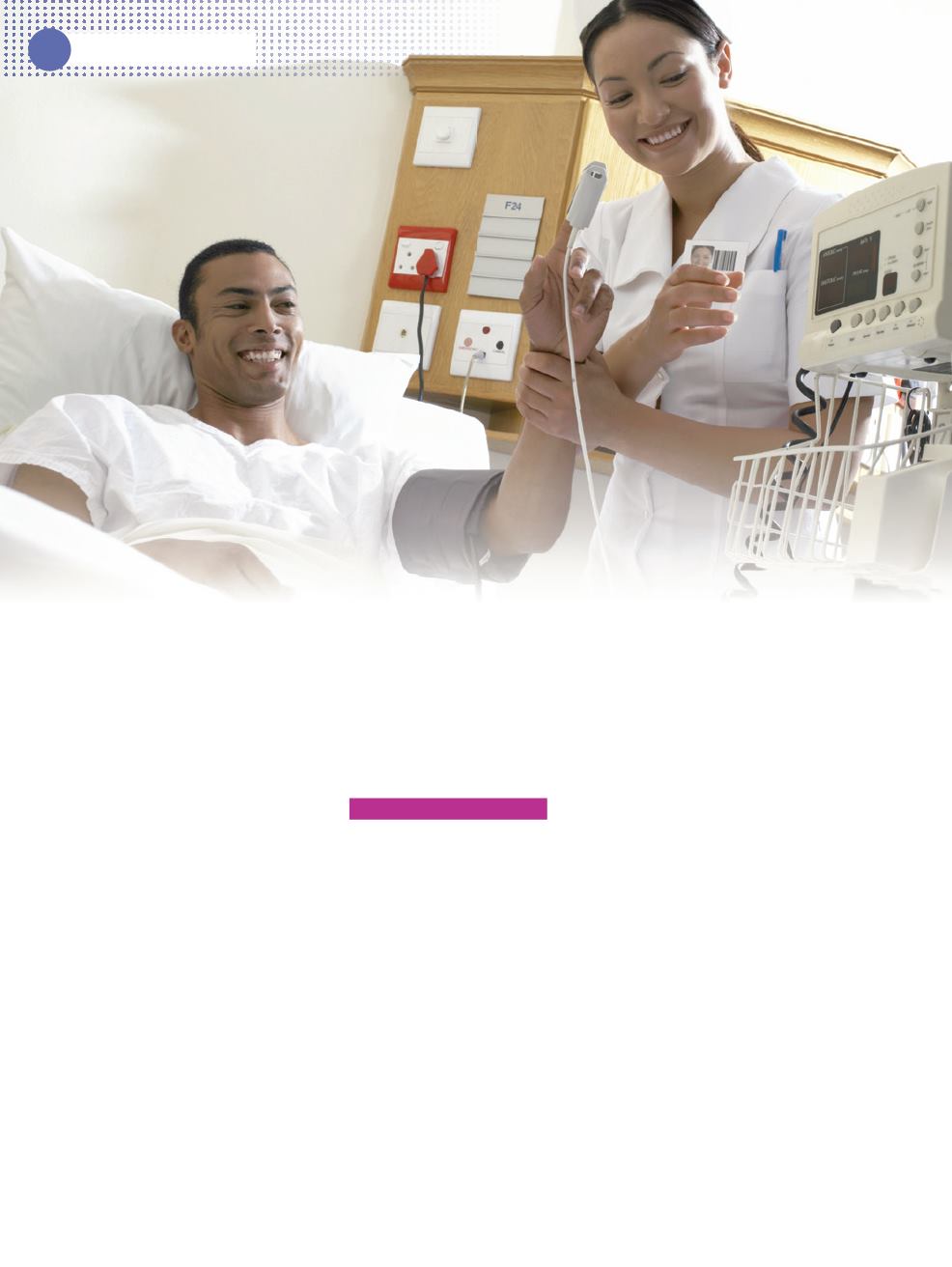
52
anform !
•
janvier - février 2015
ma
santé
de notre armoire àpharmacie. Prise
àpetites doses, elle protège le sys-
tème cardiovasculaire, notamment
grâce à sa propriété de fluidifier le
sang. Mais chez les hommes, elle
diminue le risque d'infarctus et, chez
les femmes, celui d'accidents vascu-
laires cérébraux.
EFFETS SECONDAIRES
Le problème, c'est que ni laméde-
cine ni l'industrie pharmaceutique ne
prennent en compte ces différences
hommes/femmes. Lorsde laconcep-
tiond'unmédicament, les essais cli-
niques sont majoritairement réalisés
sur des cellules masculines et sur
des animauxmâles. Pourquoi ?
“Il y
a une tendance à considérer que les
cellules féminines ont un comporte-
ment plus variable, sous l'effet des
hormones. Et on postule souvent que
les résultats obtenus sur des cellules
masculines peuvent être extrapolés
aux cellules féminines”,
poursuit Ja-
nine Clayton. Or, ces postulats sont
faux. Dans les dernières phases de
développement des médicaments,
au moment de les tester sur les
humains, l'inégalité continue. Les
hommes sont beaucoup plus sou-
vent enrôlésdans les essais cliniques
que les femmes. Pour des raisons
cohérentes, cette fois-ci. Eneffet, les
cliniciens craignent que lavolontaire
soit enceinte (sans le savoir) et que
l'essai affecte l'embryon. Par ailleurs,
la plupart des femmes suivent un
traitement contraceptif, qui peut inte-
ragir avec le médicament ou fausser
les résultats. Le résultat, c'est que les
doses de médicaments sont adap-
tées aux hommes. Or, les femmes
se montrent souvent plus sensibles à
leurs effets. Souvent surdosées, elles
développent plus d'effets secon-
daires. Àl'universitéd'Erlangen(Alle-
magne), un groupe de médecins a
fait le compte. Enobservant l'impact
de plusde 25000 traitements, ils ont
•••
© FUse
“Les hommes
sont beaucoup
plus souvent
enrôlés dans les
essais cliniques
que les femmes.”














