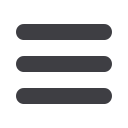

mars - avril 2017
•
anform !
151
conseillers Jafa vous rendent visite à
domicile, assurent un suivi en agro-
nomie et en nutrition et proposent
des ateliers thématiques. Ils peuvent
notamment vous conseiller sur des
cultures adaptées au niveau de
contamination de votre sol.
Comment la chlordécone
se retrouve-t-elle dans les
végétaux et les animaux ?
La chlordécone est une molécule
très persistante dans les sols. La
contamination des végétaux se fait
donc essentiellement par le sol, soit
par contact direct (c’est le cas des
racines et tubercules), soit par diffu-
sion passive avec l’eau (concerne
en particulier les cucurbitacées). La
peau des racines et tubercules est
souvent beaucoup plus contaminée
que la pulpe, autrement dit la par-
tie comestible. Chez les animaux, il
existe différentes sources de conta-
mination : ingestion de terre conta-
minée, consommation de végétaux
contaminés ou souillés par la terre
(herbe, légumes racines ou leurs
épluchures récoltées sur une terre
polluée), abreuvement à des points
d’eau polluée.
Que puis-je cultiver
sur un sol qui contient
de la chlordécone ?
Un sol contaminé par la chlordécone
n’est pas condamné. Il reste quand
même cultivable. Et tous les végé-
taux n’ont pas la même sensibilité
à la chlordécone. Par exemple, tous
les fruits ou légumes aériens (avo-
cats, fruits à pain, bananes jaunes,
oranges, mandarines, ananas…)ne
seront jamais contaminés, quel que
soit son taux dans le sol. Cela laisse
encore un choix important à nos jar-
diniers amateurs !
Puis-je planter des légumes
sensibles à la chlordécone
si mon terrain est
contaminé ?
En cas de forte quantité de chlordé-
cone dans le sol, la culture de pro-
duits sensibles (igname, dachine,
patate douce, carotte, navet…),
déconseillée en l’état, peut être
maintenue avec une adaptation
des techniques culturales, en
recourant par exemple à des sols
reconstitués. Des tables de cultures
(ou des bacs), constituées de terre
non contaminée ou d’un substrat
composé d’un mélange de terreau,
de compost, de sable ou de fumier.
Idéales pour les salades, les cives,
le persil et le thym. Il y a aussi la
culture sur tas de compost : les
plants sont placés sur un tas de
compost en plein air, alimenté par
les déchets organiques de la cui-
sine et du jardin. Excellent pour les
courgettes, concombres et girau-
mons !
Sommes-nous toujours
autant exposés
à la chlordécone ?
L’échelle de temps est
telle qu’on ne peut pas
constater une diminution
de contamination des
sols. Car la chlordécone
s’élimine très lentement.
La menace est donc
toujours présente mais
elle est globalement
bien maîtrisée par des
mesures de prévention des
risques prises à partir des
années 2000. Ces mesures
concernent les eaux, les
cultures, la pisciculture,
la pêche et l’élevage. Les
actions de prévention sont
également contrôlées
par les services de l’État.
Donc même si les sols
restent au même niveau de
contamination, les mesures
de prévention diminuent
l’exposition. Il ne faut donc
pas relâcher la prévention
et jouer le jeu, surtout les
producteurs de denrées
alimentaires. Des enquêtes
sont faites régulièrement.
L’enquête Kannari nous
apportera de nouveaux
résultats en fin d’année. On
saura, par exemple, s’il y a
une diminution de l’exposi-
tion par rapport à 2007 ou
s’il existe des groupes de
population plus exposés
(pêcheurs, population des
zones contaminées…).
Éric Godard,
chargé de mission
chlordécone à l’ARS.
© IREPS MARTINIQUE














